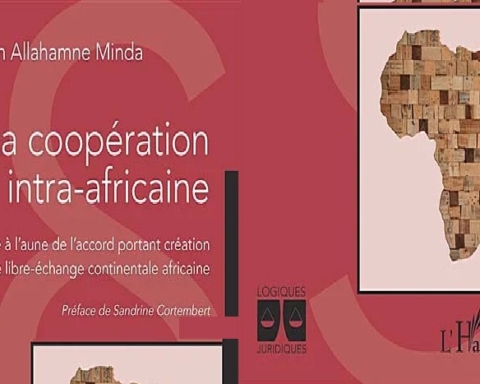Daquin voulait rejoindre l’Europe pour réaliser son rêve, devenir cuisinier. Mais après des semaines dans les camps en Tunisie, un naufrage et une expulsion dans le désert, le jeune Camerounais a finalement rebroussé chemin. Témoignage.
Daquin, 26 ans, a quitté le Cameroun le 24 janvier 2024. Il a traversé le Nigeria, le Niger et l’Algérie avant d’atteindre la Tunisie. Son souhait d’alors : traverser la Méditerranée pour s’installer en Europe et commencer une formation de cuisinier, son rêve. Daquin pensait suivre le même parcours que son cousin, passé par cette route en 2022 et installé depuis à Milan. Mais son séjour en Tunisie va tout changer.
« Je suis arrivé en Tunisie fin février 2024, soit un mois après mon départ du Cameroun. À mon arrivée, j’ai loué une chambre dans un appartement près de Sfax [dans le centre-est de la Tunisie, ndlr], au km 7 de la route qui part vers Jebeniana. J’ai pu la payer grâce à l’argent que j’avais mis de côté au Cameroun. C’était indispensable car aujourd’hui en Tunisie, c’est impossible de travailler quand on est subsaharien.

Je ne devais passer que quelques jours dans cet appartement, avant de prendre la mer. Mais le coaxeur [intermédiaire du passeur, ndlr] nous a dit qu’il s’était fait arrêter. Alors avec les autres personnes qui attendaient de partir, on a dû payer huit millions de francs CFA [plus de 12 000 euros, ndlr] pour le sortir de là. Il a été libéré. Mais nous, on ne partait toujours pas.
En attendant de monter dans un bateau, on devait rester au km 19 de la route, dans les ‘bunkers’. C’est comme ça qu’on appelle les petits abris recouverts de bâches en plastique, ceux qu’on voit dans les vidéos envoyées par les migrants. On patientait là, et le passeur, il nous demandait toujours plus d’argent. Si j’avais su, je n’aurais pas gaspillé toutes mes économies comme ça. Mais j’avais tellement envie de partir. Je recevais des nouvelles d’autres personnes du camp qui étaient arrivées en Italie, ça me rendait très envieux.

Mais la vie dans ces champs d’oliviers, c’était vraiment dur. On passait notre temps à fuir la police, on mangeait mal, on buvait très peu.
« Je fais encore des cauchemars de cette traversée »
Samedi 11 mai, le coaxeur nous a dit : ‘Tenez-vous prêts pour le départ, c’est aujourd’hui’. Il y a eu des cris de joie, mêlés de panique. Il nous a donné rendez-vous à minuit et demi sur une plage. En arrivant, j’ai vu le bateau qu’il nous avait trouvé : il était en fer et rempli d’eau. On l’a vidé un peu et ensuite j’ai aidé à le porter au large. Le fer m’a coupé les doigts.
Au moment où l’eau m’est arrivé au menton, j’ai grimpé dans l’embarcation, avec 42 autres passagers. On a démarré mais l’eau s’infiltrait déjà à l’intérieur. Avec d’autres passagers on a coupé nos bouteilles en plastique et on s’en est servi pour vider le bateau. Mais plus on avançait, plus c’était dur. La météo se dégradait. Les vagues tapaient contre la coque et faisaient pencher le canot. À chaque fois, mon cœur se soulevait. J’ai cru plusieurs fois que j’allais mourir.
Il y avait quatre femmes et un enfant de quatre ans avec nous. Je fais encore des cauchemars de cette traversée. Je rêve que je suis dans le bateau, je sens encore les vagues.

À 9h le matin, on a aperçu un navire des gardes-côtes tunisiens. Quand ils se sont approché, on les a suppliés de nous laisser continuer. Mais ils n’ont rien voulu savoir, et nous ont pris avec eux.
Quand j’y réfléchis, je me dis que finalement, c’était le destin. Si les autorités ne nous avaient pas arrêtés, je serais certainement mort.
Ils nous appelaient les ‘Africains’
Par contre, je ne m’attendais pas du tout à ce qui m’est arrivé ensuite : les gardes-côtes nous ont déposés dans le local de la Garde nationale de Sfax, et là, ils ont pris nos téléphones, nos pièces d’identité et toutes nos affaires. Je n’avais même plus de pull.
On nous a menottés avec des liens rigides en plastique et forcés à monter dans un bus. On a roulé pendant dix heures, ligotés. Si une personne demandait à un agent de desserrer les liens, il serrait encore plus. On ne devait pas les regarder dans les yeux, sinon ils nous giflaient. Ils nous appelaient les ‘Africains’. Beaucoup de personnes se sont évanouies sur le chemin. Moi je suis resté dans mon coin, sans parler, la tête baissée.
Vers minuit, le bus nous a déposés à la frontière algérienne, vers Kasserine. Les policiers nous ont crié de partir, et ils ont attendu qu’on s’éloigne vers l’Algérie. On n’avait pas le choix, on a commencé à marcher.

Deux jours plus tard, on a fini par atteindre Tebessa, en Algérie.
Là, j’ai enfin pu appeler ma famille qui était très inquiète. Quand on part en mer, on prévient ses proches, donc quand ils n’ont pas de nouvelles pendant quelques jours, ils pensent que vous êtes morts. Au téléphone, ma mère n’arrêtait pas de pleurer. Je ne savais pas quoi lui dire. C’est là, je crois, que je me suis dit que j’allais rentrer.
Avec d’autres passagers du canot, on est allé voir la police algérienne. On savait ce que ça signifiait : une autre expulsion. Mais franchement je me sentais incapable de retourner en Tunisie. Je ne voulais pas revivre ce traumatisme. Et puis j’avais dépensé toutes mes économies. Au total, avec tout l’argent que j’ai donné au passeur, cette traversée ratée m’a coûtée 2,855 millions de francs CFA [environ 4 350 euros]. L’enfer tunisien m’a convaincu de rentrer chez moi.
« On a marché en plein désert »
Je suis donc remonté dans un bus, direction le Niger. Après trois jours de voyage, le chauffeur nous a déposés au milieu de nulle part, tôt le matin. On a marché en plein désert jusqu’à Assamaka.
Les dangers de ces expulsions d’Algérie vers le Niger sont immenses. Les exilés sont généralement abandonnés par les Algériens à la tombée de la nuit. Lorsqu’ils sont lâchés, ils sont livrés à eux-mêmes. Sans eau ni nourriture, ils doivent parcourir 15 km à pied pour rejoindre le village d’Assamaka. Chaque année, de nombreux exilés disparaissent aussi sans laisser de trace dans le Sahara. Ils peuvent se perdre, mourir de déshydratation ou être victimes de groupes mafieux.
Le 24 mai, je suis arrivé dans ce petit village nigérien. Le même jour, je suis allé voir l’OIM [Organisation internationale des migrations, ndlr] et j’ai rempli le formulaire du retour volontaire. Je l’ai fait à contre-cœur, mais je ne pouvais plus rien endurer. Et le 25 juin, j’ai pris l’avion pour le Cameroun. Assis sur mon siège, je me sentais … vraiment mal. Juste avant de partir, j’ai même pensé à annuler mon départ. Mais qu’est-ce que j’allais faire au Niger ?

Depuis mon retour, je ne fais pas grand-chose. Je vis à Yaoundé chez mon grand frère avec sa femme et sa fille. J’attends encore l’argent de l’OIM pour construire mon projet : 700 000 francs CFA [un peu plus de 1 000 euros, ndlr] distribués en deux fois. Je compte sur cet argent car je n’ai plus rien, j’ai tout dépensé pour mon passage en Méditerranée.
J’aimerais que les candidats au départ se rendent compte des dangers de cette route. J’espère que mon histoire va les aider.
Malgré tout cela, j’ai toujours le même rêve : me former dans le secteur de l’hôtellerie et devenir chef dans un grand restaurant. Ma passion, c’est la cuisine. Je n’ai pas pu étudier après le bac, car j’ai dû travailler pour aider mes parents à élever mes petits frères et ma sœur. Avant de partir en Tunisie, j’étais ouvrier dans un entrepôt de poissons.
Mais cuisiner, c’est ce que je sais faire de mieux. Je peux concocter de nombreux plats de chez moi, comme le ndolé [plat constitué de légumes et d’arachides, ndlr]. Mais j’aimerais savoir faire des mets européens aussi. Je prie Dieu pour qu’il m’aide à me relever, jusqu’à ce qu’un jour, je puisse réaliser mon rêve ».