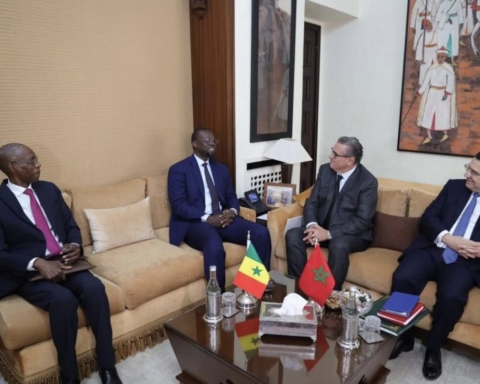REPORTAGE. Le procès de l’assassinat de Thomas Sankara, qui s’ouvre 34 ans après les faits, doit surtout à la pugnacité d’acteurs déterminés à connaître la vérité.

Par notre correspondante à Ouagadougou, Agnès Faivre
Son bureau à beau être immense et vide, il est chargé d’effervescence. « Oui, je sais, c’est difficile de m’avoir », dit en décrochant promptement son téléphone Luc Damiba, avant de reprendre l’autre fil de la conversation exactement là où il l’avait interrompu. Mais, à trois jours de l’ouverture du procès de l’assassinat de Thomas Sankara, prévue ce lundi 11 octobre, le secrétaire général du Comité international Mémorial Thomas Sankara (CIM-TS) est surtout débordé par la joie. « Nous recevons des appels de partout, du Niger, du Ghana, des États-Unis, de gens qui veulent venir assister à cet événement historique. Nos états-majors sont à bloc », dit cet ancien journaliste de 45 ans, vêtu d’une tunique noire en coton peigné. Ce procès tant attendu, il peut y croire enfin. « J – 4 », « J – 3 », poste-t-il jour après jour sur la page Facebook du Mémorial, rompant avec des années de doute. « Tout ce qui pouvait empêcher la tenue de ce procès a été tenté », souffle-t-il en égrenant les batailles pour aboutir à cette étape judiciaire, 34 ans après la mort de Thomas Sankara.

Le bureau qu’il occupe au Mémorial Thomas Sankara, projet à la mémoire de l’icône révolutionnaire lancé en octobre 2016, donne directement sur le Conseil de l’entente. Autrefois dédié à une organisation de coopération régionale, ce complexe administratif était devenu le siège du pouvoir du Conseil national de la révolution (CNR) entre 1983 et 1987. Longtemps resté inaccessible, il est ouvert au public depuis le 1er juin 2020. Et les visiteurs y affluent chaque jour. En famille, entre amis, ils posent, poing levé, à côté de la statue de bronze de huit mètres de haut de Thomas Sankara dévoilée en mars 2019. Puis poussent la grille et longent une allée de manguiers, margousiers et calebassiers jusqu’au bâtiment de briques décati où le président du CNR avait établi son secrétariat particulier. C’est là qu’il fut exécuté par un commando le 15 octobre 1987.
Blaise Compaoré absent
Qui a tué Thomas Sankara et douze de ses compagnons ? Ce crime était-il prémédité et, si oui, qui a donné l’ordre ? Qui était complice ? Les cinq membres de la cour du tribunal militaire de Ouagadougou (deux magistrats professionnels et trois assesseurs militaires) devront se prononcer sur ces questions au terme d’un procès de « trois à quatre mois », selon des sources judiciaires. Quatorze militaires ont été mis en accusation. Le plus célèbre d’entre eux, l’ex-président Blaise Compaoré, au pouvoir de 1987 à 2014, est accusé d’attentat à la sûreté de l’État, de complicité d’assassinat et de recel de cadavre. Exilé en Côte d’Ivoire et protégé par sa nationalité ivoirienne récemment acquise, il a choisi de ne pas comparaître devant la justice. Ses avocats, Mes Abdoul Ouedraogo et Pierre-Olivier Sur, dénoncent un « procès politique » et invoquent l’immunité que lui confère son statut d’ancien chef d’État. Et puis, minimise un de ses proches, « Blaise Compaoré n’est plus une menace pour personne, il est fatigué ».

En mai, le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale Zéphirin Diabré l’a pourtant rencontré pour discuter d’un éventuel retour au pays. « Il aurait accepté au début, avant de se rétracter. C’est dommage », regrette maître Bénéwendé Sankara (sans lien de parenté avec Thomas Sankara, NDLR), qui a joué un rôle majeur dans cette procédure judiciaire. « On ne comprend pas qu’il ne vienne pas, mais ça n’engage que lui, balaie de son côté Luc Damiba, imperturbable. Il a déjà subi une sanction en étant délogé du pouvoir par l’insurrection populaire d’octobre 2014, en quittant son pays. Et puis, s’il ne veut pas se soumettre à la justice des hommes, il ne peut pas échapper à sa conscience ni à la justice divine. Nous, on ne cherche pas la vengeance, notre but n’est pas de le voir croupir en prison. Tout ce qu’on veut, c’est la vérité. Savoir qui a fait quoi. »
Péripéties judiciaires
Si cet épisode de l’histoire contemporaine burkinabée s’apprête à être examiné par la chambre de première instance du tribunal militaire, c’est grâce à la ténacité et aux pressions d’acteurs divers. Mais, en premier lieu, à maître Sankara qui a accepté de domicilier à Ouagadougou, dans un contexte hostile, la plainte pour assassinat de Thomas Sankara. Elle était soutenue par un collectif d’avocats et d’organisations diverses, dont le Grila (Groupe d’information et de recherche pour la libération de l’Afrique), comme le retrace Bruno Jaffré, biographe de Thomas Sankara, sur son blog. La plainte est ainsi enregistrée le 3 octobre 1997 par le tribunal militaire, quelques jours avant le terme de la prescription décennale. Un acte courageux. « À l’époque, c’était même suicidaire », nuance Me Prosper Sankara, avocat de quatre des treize parties de ce procès, et stagiaire au cabinet de Me Sankara en 1997. « Un avocat a besoin de clients », justifie, modeste, ce dernier. Puis il poursuit : « J’ai accepté sans sourciller. Je faisais partie de ceux qui avaient juré de réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara, de lutter pour que son idéal survive et de perpétuer son œuvre. Donc je n’avais pas peur de prendre ce dossier. »PUBLICITÉ
La suite est une succession de blocages, de ruses, d’attaques et de contre-attaques. « Dans toute la chaîne judiciaire, de la première instance jusqu’en cassation, pas un seul juge n’a dit « il faut instruire ce dossier ». Ça a été 15 ans d’inertie, avec des juges acquis, le mot était d’ailleurs du ministre de la justice lui-même », soupire maître Sankara. En 2002, le Comité international justice pour Sankara (CIJS), composé d’une quinzaine d’avocats internationaux, dépose une plainte contre le Burkina Faso devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU pour violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Burkina Faso en 1999. La plainte est jugée recevable, et Ouagadougou, sommé par ce comité onusien d’élucider l’assassinat de Thomas Sankara. « Le parquet nous dit alors qu’il ne fera rien. On en a déduit que, s’il refusait d’instruire, cela signifiait que Thomas Sankara n’était pas mort, et on a lancé une nouvelle procédure pour séquestration et enlèvement ! Et là, ils ont brandi le certificat attestant du décès par « mort naturelle » de Thomas Sankara. C’était ridicule », résume Bénéwendé Sankara. Ridicule et tragique. Ces péripéties se déroulent dans un climat de peur. Le 13 décembre 1998, le journaliste Norbert Zongo est assassiné avec ses trois coéquipiers alors qu’il enquête sur la mort mystérieuse de David Ouédraogo, chauffeur du frère du président, François Compaoré. « À l’époque, il y avait cette fameuse formule qui a emporté Norbert Zongo : « Si tu fais, on te fait et y’a rien. » C’était atypique, mais ça traduisait la barbarie du régime », se souvient le conseil.
L’insurrection de 2014 déterminante
Dans son studio Abazon du quartier de Wemtenga, attaqué en 2015 et incendié par des putschistes, le rappeur et activiste Smockey cite la même formule, qu’il ponctue d’un long silence. Comme si elle le glaçait toujours. « C’était le slogan du redoutable Régiment de sécurité présidentielle (RSP). Ça voulait dire « si tu dis quelque chose, on t’élimine et le problème est réglé » », traduit-il. Le RSP, créé en 1995, était dirigé par le général Diendéré, bras droit loyal à Blaise Compaoré. Purgeant actuellement une peine de prison liée à l’affaire du putsch de 2015, il sera sur le banc des accusés ce lundi, poursuivi pour les mêmes chefs d’accusation que l’ex-président.

Smockey a cofondé en 2013 avec le musicien et animateur radio Sams’K Le Jah Le Balai citoyen. Un mouvement politique qui a fortement contribué à mobiliser les Burkinabés lors de l’insurrection populaire de 2014, tout en brandissant des idéaux sankariens. Smockey, âgé de 12 quand débutait la révolution démocratique et populaire en 1983, les résume ainsi : la « dynamique » impulsée par les programmes culturels et sociaux, « le culot de Sankara de dire haut et fort la vérité », « son intégrité qui le conduisait à reverser dans les caisses du Trésor un don reçu à l’étranger », ou « sa volonté de sortir le Burkina Faso du sous-développement par tous les moyens pour en finir avec cette histoire de PPTE (pays pauvre très endetté) ». « Sankara nous proposait la PPE : la politique par l’exemple », ajoute-t-il fièrement. Le 31 octobre 2014, au troisième jour des soulèvements à travers le pays, Blaise Compaoré donnait sa démission et fuyait à Abidjan, après vingt-sept ans de règne.
« Tout le monde savait que, tant que le régime de Blaise Compaoré serait en place, aucune affaire, qu’il s’agisse de l’assassinat de Thomas Sankara ou de celui de Norbert Zongo, n’aboutirait. À partir de l’insurrection populaire d’octobre 2014, tout s’est mis en marche très vite. Le 6 mars 2015, le procureur militaire délivrait l’acte de dénonciation des faits permettant d’ouvrir l’instruction », reprend Me Prosper Farama. Mais la pression de la rue ne faiblit pas pour autant. « La soif de justice avait été entendue par les autorités, mais on était encore méfiants, surtout à l’approche de la présidentielle de novembre 2015. Aujourd’hui, on estime que le président Roch Kaboré a tenu bon », se satisfait Luc Damiba.
Disjonction du volet international
Parallèlement à cette pression sur le plan national, les organisations de la société civile burkinabée ont aussi appuyé la demande de déclassification d’archives des ministères français des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur et de la présidence de la République, émise par le juge d’instruction François Yaméogo en mars 2016. Cette démarche visait à faire la lumière sur d’éventuelles complicités étrangères, françaises en l’occurrence, dans l’assassinat de Thomas Sankara, mais Paris semble avoir tardé à transmettre les lots d’archives. La question de la transmission d’archives déclassifiées par Paris a donc de nouveau mobilisé, à Ouagadougou, le 15 octobre 2017. Elle a été remise sur la table par des acteurs comme Smockey, approchés par des émissaires du Conseil présidentiel pour l’Afrique peu avant la visite du président Macron à Ouagadougou, en novembre 2017. Lequel, interrogé par une étudiante de l’université Ki-Zerbo lors de son discours du 28 novembre, s’est finalement engagé à déclassifier les archives liées à la période de la révolution.
Le volet des complicités étrangères a cependant été disjoint de l’enquête, et ne sera donc pas abordé. « Cela reflète essentiellement la difficulté d’avoir accès aux documents secret défense. Un nouveau juge est chargé de poursuivre l’instruction (sur le volet international). En aura-t-il les moyens et la ténacité ? Nous ne pouvons que l’espérer », estime le biographe de Thomas Sankara Bruno Jaffré. Il est également membre du Réseau international justice pour Sankara, justice pour l’Afrique, qui a aussi participé à de nombreuses actions en France pour réclamer l’ouverture d’une enquête internationale indépendante, puis d’une enquête parlementaire sur l’assassinat de Thomas Sankara.. et le déverrouillage des archives classifiées liées à cette période.
« Le volet du complot international est beaucoup plus compliqué, car il n’y a pas que la France. Il aurait aussi fallu que la Côte d’Ivoire, le Togo ou la Libye coopèrent », tempère aujourd’hui Me Sankara, qui préfère regarder le verre à moitié plein. « Même si la France n’a pas joué franc jeu, on est fiers aujourd’hui de notre justice nationale, estime quant à lui Luc Damiba. Nous allons malgré tout connaître la vérité, et c’est ce que les victimes et de nombreux Burkinabés attendents. Ici, tant qu’on ne connaît pas les circonstances de la mort, on ne peut pas organiser de funérailles. »