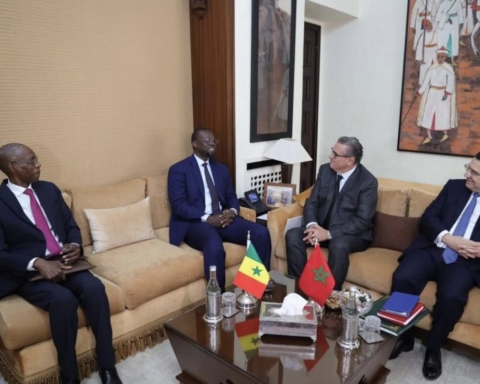Quand l’Europe renvoie la crise migratoire de l’autre côté de la Méditerranée (7). Coincés dans le nord du Maroc, des Subsahariens racontent leur quotidien marqué par le racisme et la misère.

Devant ce qui ressemble à un garage abandonné, Moussa* frappe à la porte. Six coups, dont seuls les habitués connaissent le rythme. « C’est un code pour entrer, précise-t-il. Si quelqu’un toque normalement, on soupçonne la police. » Josiane*, une Camerounaise de 35 ans, ouvre alors la porte. A l’intérieur, une dizaine de migrants subsahariens se sont retrouvés là pour « discuter, boire, oublier la misère ». Tous les soirs, on y sert de la bière et du vin à petits prix. La décoration est sommaire : lumière blanche, meubles récupérés dans les souks et quelques affiches au mur représentant des icônes africaines.
Tenu par un couple de Camerounais, ce bar improvisé a ouvert dans la plus grande discrétion il y a près d’un an et demi, à l’été 2016, dans un quartier à moitié construit en périphérie de Tanger. Les clients exclusivement subsahariens se méfient des inconnus ou des voisins indiscrets qui pourraient alerter la police. Car ici tout est illégal. L’alcool de contrebande, le loyer payé sous le manteau, « même nous, on est sans papiers », ironise Moussa.
Violences policières
Cet homme de 44 ans, né d’une mère camerounaise et d’un père guinéen, a marché dans le désert algérien pendant deux mois avant d’arriver sur la côte méditerranéenne. « Mais la police algérienne nous a ramassés puis jetés dans le désert, au milieu de nulle part. On était cent vingt, douze ont survécu. » Quand il décide de refaire le trajet, en passant par le Maroc cette fois, Moussa doit se cacher pendant un an dans la forêt de Gourougou, « comme un animal », pour fuir la police. « Je suis enfin arrivé ici en 2014. »

Tanger, le dernier arrêt avant l’Europe. Du moins, c’est ce qu’il pensait. Moussa a tenté la traversée une dizaine de fois. « J’ai tout essayé. Sur une barque, à la nage. A Melilla, j’ai été refoulé. Et même quand j’ai réussi à atteindre la péninsule, on m’a renvoyé au Maroc. » Après cinq refus de demande d’asile, il finit par abandonner. Comme des milliers de migrants clandestins qui n’ont pas réussi à passer la frontière, Moussa s’est résigné à rester au Maroc. « On fait des petits boulots, on a nos habitudes, notre cercle, notre bar. » Mais la plupart ne parviennent pas à percer la bulle de l’entre-soi. « Le Maroc, c’est dur. On n’est pas les bienvenus ici. On n’arrive pas à s’intégrer. »
Epinglé par les défenseurs des droits humains pour maltraitance envers les migrants subsahariens, le Maroc a depuis revu sa politique migratoire. Alors que les Européens cherchent à limiter l’afflux des clandestins et que son voisin algérien a durci sa politique sur cette question, le royaume chérifien veut se positionner en terre d’accueil en multipliant les campagnes de régularisation. C’est que l’immigration est un enjeu diplomatique pour le gouvernement marocain, soucieux de son rayonnement sur le continent après avoir réintégré l’Union africaine au début de l’année. Mais la nouvelle politique d’intégration a ses limites : discrimination, mauvais traitements, violences policières… Tous les jours, ces hommes et ces femmes continuent d’endurer le harcèlement.
« En bas de l’échelle »
Dans le bar tangérois, on aborde rarement ces problèmes. « Ici, c’est notre espace de liberté, là où on peut enfin respirer », insiste Moussa. Autour de lui, l’ambiance n’est pas à la fête. Les migrants viennent pour boire, « pour planer », disent-ils. Petit à petit, les langues finissent par se délier. « Dans la forêt, ils [la police] nous tabassent », raconte un ami de Moussa assis à la même table. Victimes de racisme au quotidien, malgré les campagnes antiracistes lancées au Maroc, ils racontent : « Certains chauffeurs de taxi refusent de nous prendre. On nous bouscule dans la rue. On nous insulte, on nous traite de “azzi”. » Azzi signifie « nègre » en arabe dialectal marocain. « Même les mendiants nous insultent. On est au plus bas de l’échelle, des sous-hommes », renchérit Frank*, un Nigérian de 35 ans qui raconte avoir a fui les massacres de Boko Haram.
Au quotidien, ces Africains subsahariens se heurtent à de nombreux obstacles. « Je fais des petits boulots par-ci par-là. Au début, le patron a accepté de me prendre et, du jour au lendemain, il a refusé de me payer sous prétexte que je n’ai pas de papiers », confie à son tour Moussa. Travail au noir, marchands de sommeil, trafics, une véritable économie parallèle se fait sur le dos des migrants. Des propriétaires sans scrupule profitent de leur situation pour leur faire payer des loyers faramineux. « Et quand on n’a pas les moyens, on squatte des bâtiments abandonnés. Parfois les voisins nous dénoncent et là, la police nous embarque. »
Pour Frank, prison est synonyme d’enfer. « On nous met dans le même quartier que les malades mentaux ou les gens atteints de maladies infectieuses. Et quand j’ai eu le malheur de parler, le flic m’a dit : “Déjà, tu viens foutre la merde dans mon pays et en plus tu te plains ?”»
Au fil des conversations, ils arrivent malgré tout à oublier les nuits de froid, les séjours en prison, les raclées. « Lorsqu’on vient dans le bar, on parle de nos projets, de choses positives »,explique Frank. Passionné de photographie – il expose ses photos sur une page Facebook qui compte près de 20 000 fans –, le jeune Nigérian a un rêve : « Faire la route inverse, de Tanger à Lagos, et prendre en photo toutes les scènes qui marquent le voyage d’un migrant vers l’Europe. »
A travers l’objectif, Frank veut montrer au public « ce que les médias ne peuvent pas montrer ». « On voit toujours les mêmes images à la télé. Les migrants accrochés aux barbelés dans les enclaves espagnoles ou les morts en Méditerranée. Mais tous ces enfants qui meurent de faim dans les déserts marocain et algérien, tous ces migrants assassinés sur le trajet ? Ils n’existent pas. »
Mais l’élan positif ne dure pas longtemps. Entre drogue et alcool, les soirées finissent souvent en bagarre. Dans une ville comme Tanger, propice aux trafics, les substances sont facilement accessibles. « Après ce qu’on a vécu, c’est soit ça, soit on sombre dans la folie », tranche Moussa. Certains deviennent dealers, renforçant ainsi le rejet d’une population pour qui clandestins et délinquants ne font qu’un.
Les prénoms ont été changés.
lemonde.fr